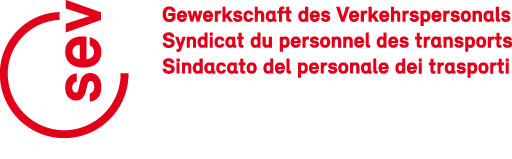Réseaux et plates-formes permettent d’externaliser toujours plus de tâches et compétences
Et si un algorithme nous gouvernait …
Comment se porte le monde du travail ? Mal, nous répond le professeur Lelio Demichelis, qui a analysé les profonds changements dans un monde du travail devenant de plus en plus fragmenté, ubérisé et individualisé. Un monde en pleine transformation qui comporte des défis aussi pour les syndicats. Sociologue et économiste, il enseigne à la SUPSI à Lugano et écrit notamment sur le « techno-capitalisme ».

Professeur Demichelis, la révolution technologique est en train de modifier complètement le monde du travail et les professions. La robotisation des tâches dans la production et la numérisation croissante ont un impact certain et ce phénomène va encore s’accroître à l’avenir. Comment évaluez-vous la situation dans le monde du travail ?
Il ne se porte pas bien. Pas parce qu’il n’arrive pas à suivre sur le plan technologique, bien au contraire. En fait, cela se produit dans toutes les phases de la révolution industrielle : à chaque fois, on crée puis on détruit les modes de travail. Mais ce qui est encore plus important (et c’est ce qui donne matière à réflexion) c’est qu’à chaque fois, la société se transforme profondément car elle devient toujours plus technique sur le plan de son organisation.
A la Silicon Valley, il s’est imposé durant les trente dernières années une idéologie néolibérale prônant la transformation de la société en marché et de la vie en compétition. Le fait est qu’aujourd’hui, l’omniprésence et l’invasion des technologies sont bien pires qu’autrefois ; et aujourd’hui, l’apprentissage automatique (ou « machine learning ») et les algorithmes auto-programmés sont en train d’aliéner l’homme, que ce soit (selon Marx) au niveau des moyens de production ou de la «décision souveraine» sur « ce qu’il faut faire », « comment le faire » et dans quel « but ». Nous déléguons ainsi toujours plus notre vie – faire, consommer, vivre, s’informer, communiquer, aimer - aux machines et aux algorithmes : c’est ça la grande différence avec la technologie du passé.
Le rapport triangulaire entre la personne, la technologie et l’occupation n’est pas nouveau. L’économiste britannique John Maynard Keynes parlait en 1930 déjà de « chômage technologique ». Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui par rapport à cette époque ?
Keynes (en 1930) a évoqué le chômage technologique comme étant une nouvelle «maladie» de la société avancée due à la découverte d’instruments toujours différents permettant d’économiser la main d’oeuvre, et au fait que ces technologies ont progressé plus rapidement que les nouveaux métiers qui ont été développés pour la main d’oeuvre expulsée. Mais Keynes définissait cette « maladie » comme étant passagère car il croyait au progrès. Par contre, la technologie d’aujourd’hui non seulement recrée et multiplie l’ancien déséquilibre entre les emplois perdus et créés mais elle le fait bien plus rapidement qu’à l’époque. C’est pourquoi il est difficile d’imaginer des « effets compensatoires » positifs et durables du chômage actuel si, demain déjà, nous serons probablement confrontés à un nouveau chômage technologique qui, désormais, ne sera plus passager mais systématique et structurel. Parce qu’il ne faut pas oublier que la « destruction créatrice » de Schumpeter (aujourd’hui renommée «disruption») a besoin justement de détruire (beaucoup et tout le temps) en faisant abstraction de l’utilité sociale des innovations. De plus, aujourd’hui, le système préconise que nous « devons nous adapter » au changement et à la « disruption ». Pourtant, si nous ne sortons pas de ce déterminisme technologique, nous serons de plus en plus gouvernés par les algorithmes. Et nous passerons alors (ou sommes-nous déjà passés?) de la démocratie à l’algocratie.
L’arrivée d’Uber a profondément changé le monde du travail et a donné naissance au modèle d’ubérisation du travail. Quels en sont les pièges et les conséquences ?
Uber a exploité une nouvelle forme d’organisation du travail issue des réseaux. Je rappelle que le système que je qualifie de techno-capitaliste se base sur un « double mouvement » toujours égal même s’il semble être toujours différent. Autrement dit, il faut d’abord subdiviser, individualiser, parcelliser le travail (et la consommation et la vie) pour ensuite recomposer, intégrer, totaliser les parties subdivisées en quelque chose de plus grand que la simple somme arithmétique des parties. Et ce quelque chose se nomme organisation, connexion en réseau et « internet des objets et des hommes ».
Si, dans les années 1900, cette recomposition ou organisation des hommes et des machines s’appelait une chaîne de montage et avait besoin d’un lieu « physique » concentré où elle pouvait se réaliser (la fabrique, le bureau) aujourd’hui, le réseau ou la plate-forme permet d’externaliser une quantité croissante de tâches, de compétences, de professionnalismes et de les payer selon la demande, quand on en a besoin, et pour le temps dont on en a besoin. Il s’agit à la fois d’une évolution et d’une involution du « just in time » des années 70.
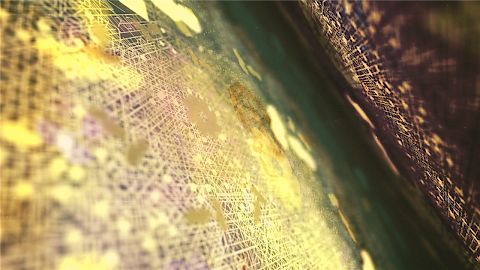
Cela implique que le travail change et requiert une flexibilité préventive. Toutefois, toutes les opportunités numériques s’évanouissent bien vite devant la précarisation du travail, l’ambiguïté du « digital labour » et l’illusion d’un auto esprit d’entreprise promis par la plate-forme. Quel est votre regard sur les opportunités et les dangers ?
Le chauffeur d’Uber «croit être sa propre entreprise» parce qu’il a les moyens de production (la voiture, le smartphone) mais il oublie que le véritable moyen de production, c’est la plate-forme. En fait, le digital labour est un travail exploité plutôt que rémunéré et il frôle les limites du travail gratuit. Nous sommes entrés dans le « capitalisme des plates-formes ».
La flexibilité est née dans les années 70, une décennie de stagnation, d’inflation et de chômage dont le système avait besoin de sortir avec une nouvelle phase de « destruction créatrice » … puis arrivent la globalisation, la dérégulation des marchés financiers et du travail et les réseaux, et aujourd’hui la numérisation.
Selon un rapport récent de l’Organisation internationale du travail, le travail salarié représente seulement la moitié des emplois dans le monde, dont seulement 45% sont des emplois fixes à 100%. De nouveaux défis aussi au niveau démocratique et social ?
Ford n’aimait pas les syndicats, Taylor non plus (« une entrave à la liberté de l’entreprise »). Aujourd’hui, les syndicats sont mis en danger par la technologie des réseaux et un individualisme néolibéral erroné qui s’attaque au travail, permettant à l’entreprise de l’organiser sans l’intervention du syndicat et de conclure des contrats individuels qui remplacent les CCT. Diviser pour mieux régner, grâce à la technique. Depuis 1945 jusqu’à la fin des années 70, le capitalisme a dû s’accomoder de la démocratie. Mais dès les années 80 il a repris les commandes du monde, il a substitué la compétition à la solidarité (qui ne convient pas à la « destruction créatrice ») et a réduit le travail au niveau d’une marchandise toujours plus low cost. Si, durant une bonne partie du 20e siècle, la démocratie a réussi à franchir les grilles des fabriques, aujourd’hui ce sont les grilles des plates-formes qu’il faut arriver à passer pour parvenir jusqu’à la Silicon Valley, afin de l’obliger à prendre en charge les coûts sociaux de ses propres produits avec ses propres innovations (trop facile de s’en tenir qu’aux profits !).
Le défi concerne aussi les syndicats qui ont construit durant des années leurs bases syndicales et leurs rapports de force sur les lieux de travail, les fabriques et les contacts personnels. Si les lieux de travail deviennent virtuels, quelles voies et quelles stratégies demeurent pour les syndicats ?
La première chose à faire est de prendre conscience qu’aujourd’hui, la technique constitue une nouvelle force qui n’est pas gouvernée par le peuple souverain. Ce n’est pas non plus un pouvoir qui émane d’une entreprise. Pour arriver à cette conscience, il faut sortir de cette « fable technologique » disant que le réseau est libre et démocratique, qu’il existe une économie de partage post-capitaliste et que Facebook puisse être véritablement « social ». Et même si le néolibéralisme se propose de démolir la société au nom d’une promesse de liberté absolue des individus, il faut dire avec force que cette promesse est fausse et que le «je» n’existe pas, qu’il n’est pas libre tant qu’un « nous » n’existe pas, tout aussi libre.
Si on la compare aux autres révolutions industrielles, en quoi celle-ci est différente ?
Elle est différente selon les termes que j’ai énoncés au début mais toujours égale en termes de « double mouvement ». Parce que la technique n’est plus un moyen et elle n’est pas neutre, mais c’est quelque chose qui devient dangereusement autodidacte, donc capable – et c’est le propre des algorithmes – d’être en même temps « le sujet qui donne l’ordre et l’objet de cet ordre qui a été créé par lui-même ». La technique nous a échappé des mains. Nous devons en reprendre le contrôle.
Françoise Gehring/MV
Algorithme ?
A la base, un algorithme c’est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème ou d’obtenir un résultat. C’est une façon de décrire dans ses moindres détails comment procéder pour faire quelque chose. Comme quand on suit une recette de cuisine. Sur le web sont apparus les algorithmes qui étudient la popularité des pages web. Google a connu son succès grâce à l’instauration d’un nouveau type d’algorithmes qui calculent non plus la popularité mais l’autorité des pages web. D’autres visent à prédire ce que veulent les internautes en fonction de ce qu’ils ont fait dans le passé, en fonction des traces laissées dans leur sillage lors de leurs précédents passages sur internet. En 2016, les équipes de Trump se seraient servis d’un algorithme pour le faire élire.
ysa