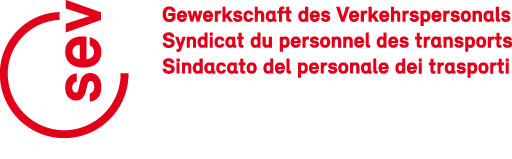Selon le professeur Sergio Rossi, l’enseignement au sein des facultés d’économie n’est plus adapté à la réalité
« Etat et marché sont complémentaires »
Lors du sixième anniversaire de la grève des ateliers de Bellinzone, le professeur Sergio Rossi a analysé avec lucidité les problèmes actuels de notre société. contact.sev a souhaité approfondir certains aspects. Entretien.

contact.sev: Sergio Rossi, vous vous occupez de macroéconomie. De quoi s’agit-il en fait ?
Sergio Rossi: La macroéconomie concerne l’ensemble de l’économie, avec tous ses sujets: les entreprises, les banques, les familles, l’Etat, qui interagissent à travers différents marchés, nationaux et internationaux. D’une part, il s’agit d’analyser les relations entre ces différentes catégories de sujets, qui influencent nombre de grandeurs économiques, telles que les prix, les salaires, l’inflation et le chômage. D’autre part, il s’agit d’évaluer les politiques économiques et leurs objectifs: la politique financière des collectivités publiques et la politique monétaire de la banque centrale, qui devraient contribuer à la stabilité économique et financière au plan national, en favorisant l’emploi et le développement durable.
En fait, le monde tourne autour de la macroéconomie...
Oui, et il y a deux approches: celle des néolibéraux, qui demandent à tout prix moins d’Etat et plus de marché, et celle de ceux qui, comme moi, prétendent que l’Etat et le marché sont complémentaires. L’histoire a montré qu’une économie planifiée par l’Etat ne fonctionne pas, mais aujourd’hui on peut constater les limites d’une économie basée uniquement sur le libre marché. Je soutiens une économie « sociale de marché », dans laquelle l’Etat pallie les manquements du marché et que ce dernier réalise les tâches dont l’Etat ne parvient pas à s’occuper efficacement.
La vertu serait au milieu...
Exactement: un système planifié ne stimule pas l’initiative personnelle, tandis que le libéralisme mène à d’autres extrêmes, surtout en ce qui concerne la répartition toujours moins équitable des revenus. Le marché n’est pas en mesure à lui tout seul de régler tous les problèmes. Les CFF en sont un exemple : ils ne sont pas le fruit d’une volonté de monopole de l’Etat, mais du fait qu’aucun acteur privé n’était prêt à investir l’argent nécessaire au rail. L’Etat a donc comblé une lacune de l’économie privée, qui montre désormais un certain intérêt pour le transport ferroviaire, limité toutefois aux seuls secteurs rentables. Les autres peuvent rester en mains étatiques selon cette logique marchande des privatisations.
Il semble qu’aujourd’hui le seul moyen de résoudre les problèmes soit le recours à l’initiative individuelle, réduisant au minimum l’intervention de l’Etat.
C’est aussi une question de rhétorique. De nos jours, on parle beaucoup des lacunes et des erreurs de l’Etat, ou de phénomènes tels que la corruption pour prétendre que la seule véritable alternative est le libéralisme où, cependant, l’engagement personnel n’est dicté que par la recherche du gain maximum. Et lorsqu’il devient évident que le libre marché ne fonctionne pas toujours correctement, on en tient pour responsable l’Etat de l’avoir mal réglementé.
Est-il possible de réglementer les marchés ?
Il faut tenir compte de certains mécanismes: le prix d’un bien, telle une voiture, dépend de l’offre et de la demande. Si celle-ci augmente et que l’offre ne peut suivre, le prix de la voiture tend à prendre l’ascenseur. Avec la hausse du prix des voitures, la demande va diminuer, ce qui va faire baisser les prix. Sur les marchés financiers, ce mécanisme n’est pas présent. Quand le prix d’une action monte, nombreux sont ceux qui y voient la possibilité d’en retirer un gain et décident d’en acheter, faisant alors grimper le prix, en spirale, au risque d’enfler une bulle. Lorsqu’il devient évident que le prix de l’action est complètement déconnecté de la valeur de l’entreprise, la bulle éclate et peut endommager tout le système. La banque centrale pourrait décider d’intervenir quand l’écart entre la valeur de l’entreprise et le prix de ses actions dépasse une limite prédéterminée. Ou l’Etat pourrait fixer une durée minimale pour la possession des actions, en deçà de laquelle la vente de celles-ci impliquerait le paiement d’une taxe, comme l’a proposé l’économiste James Tobin. Il s’agit, du reste, d’interventions qui sont déjà prévues dans d’autres secteurs tels que l’immobilier. Nous ne pouvons pas continuer à penser que le marché se règle seul. Cela est aussi valable pour le marché du travail, qui doit être réglementé correctement.
Le peuple suisse vient pourtant de repousser l’initiative sur le salaire minimum…
Certaines règles sont néanmoins nécessaires. Nestlé, par exemple, a fixé des niveaux pour les salaires de ses cadres qui sont ensuite adaptés en tenant compte des coûts de la vie des pays où ils travaillent, afin de leur offrir un pouvoir d’achat comparable. En Suisse, on pourrait avoir un système similaire, qui tienne compte des différences de coûts de la vie des différentes régions. L’Etat pourrait en outre intervenir sur la base d’autres facteurs tels que la planification du territoire, la valorisation des régions périphériques, la gestion du paysage, en appliquant une imposition différenciée afin d’encourager les entreprises à s’installer en dehors des centres. Les problèmes liés aux divers coûts de la main-d’œuvre doivent être résolus sur le plan de l’offre des places de travail et pas en exigeant des employés qu’ils se déplacent car, au-delà de leurs qualifications, ils sont par nature limités dans leur mobilité.
Mais ce n’est pas justement la concurrence fiscale qui augmente la pression sur les structures et les employés ?
C’est vrai. En Suisse, nous sommes passés d’un système basé sur la collaboration et la solidarité entre les cantons à un système se fondant sur la concurrence, dans lequel ne parvient à faire baisser la charge fiscale pour attirer de nouvelles firmes que le canton ayant déjà une masse critique d’entreprises. De cette manière, la concurrence fiscale fait d’énormes dégâts, car les pertes de recettes fiscales sont importantes. Or, ces recettes devraient être réparties par le biais d’une péréquation afin de venir en aide aux cantons les plus faibles, au lieu de les mettre encore davantage sous pression. On introduit aussi la concurrence entre les travailleurs, en individualisant les négociations dans les rapports de travail – en vidant les contrats collectifs de travail de leur contenu et en introduisant des concepts tels que le salaire au mérite. En outre, étant donné que les conditions pour une évaluation objective des mérites individuels ne sont pas réunies – vu que les processus de travail sont toujours plus interdépendants –, le salaire dépend davantage des capacités à négocier que des compétences professionnelles de l’individu. L’individualisation des négociations renforce la position des employeurs, surtout lorsque le taux de chômage est élevé. Le plein-emploi n’est plus en effet un objectif de politique économique, alors que le chômeur est culpabilisé; il lui est reproché de manquer de mobilité, de ne pas être suffisamment compétent et de peser sur les assurances sociales. On fait toutefois l’inverse pour les top managers.
Qu’entendez-vous par là ?
En vue de la votation 1:12, j’ai participé à un débat avec le CEO d’UBS, Sergio Ermotti, qui soutenait que sa rétribution de 8 millions de francs était méritée et que si le CEO d’une banque concurrente devait percevoir 10 millions de francs, il devrait en être de même pour lui. Il n’y a aucun critère permettant de justifier de telles rémunérations, mais l’effet est complètement différent.
Comment en est-on arrivé à de telles sommes ?
Pour deux raisons: la première vient du fait que les rémunérations des managers doivent être publiées et ceci a engendré de la surenchère. La seconde réside dans le lien qui est fait entre leurs salaires et les bénéfices de l’entreprise, ainsi que leur capacité à verser des dividendes à leurs actionnaires. Négligeant les autres parties concernées, employés compris.
La transparence des salaires ne devait-elle pas permettre d’en limiter l’augmentation?
C’était le but, en effet, mais ça ne marche pas dans la mesure où la majorité des actionnaires des grandes entreprises est institutionnelle et est intéressée par les bénéfices à court terme. Nous revenons ainsi à la priorité donnée aux variables financières, comme l’apprennent les étudiants au sein des facultés d’économie et dans les « business schools », qui leur apprennent à maximiser la valeur boursière de l’entreprise, indépendamment de la mission de celle-ci, et les poussent à gérer les ressources humaines comme de la marchandise. Ce changement est significatif: autrefois on parlait du personnel, aujourd’hui des ressources humaines; un concept qui implique leur optimisation permanente, soit d’en tirer le maximum, puis de les remplacer lorsqu’elles tombent malades ou deviennent trop âgées, négligeant par ailleurs que les employés et les employées sont également des consommateurs qui, dès lors, soutiennent l’économie. C’est une question d’échelle: si les classes inférieures sont trop peu payées, en fin de compte, elles doivent recourir à l’aide de l’Etat.Il y aurait donc tout intérêt à ce qu’elles soient mieux rémunérées de façon à pouvoir vivre de leur salaire.
Vous êtes très critique envers le système enseigné au sein des facultés d’économie. Pourquoi ne modifient-elles pas leurs cours ?
Deux réponses: tout d’abord, il y a une conviction profonde que le marché est dans tous les cas meilleur que l’Etat. La deuxième est dictée par des intérêts personnels et professionnels: en suivant la pensée dominante, il est plus facile de faire une carrière académique. Nous vivons une vraie crise des sciences économiques. Si, avant la crise économique, on tolérait les chercheurs qui soutenaient des thèses différentes du libéralisme, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Milton Friedman a été très habile, non seulement en proposant sa propre vision néolibérale, mais aussi en discréditant la classe politique et les réglementations étatiques, marquant de son empreinte l’ensemble du cursus de formation. Nous avons donc importé des Etats-Unis, outre l’idéologie, aussi un système entier qui se reproduit au sein des facultés d’économie du monde occidental.
Nous n’en sortirons donc jamais ?
Au mois de mai a été publié l’appel de plus de 40 associations d’étudiants du monde entier qui revendiquent urgemment de revenir à davantage de pluralisme dans l’enseignement de l’économie. Les économistes sont des scientifiques et, en tant que tels, ils doivent pouvoir approfondir les tensions entre différents paradigmes afin de trouver les meilleures solutions aux problèmes de notre époque. Il est impératif qu’il y ait plusieurs visions qui se côtoient afin de répondre de manière adéquate aux défis du 21e siècle. Hélas, nous ne sommes plus beaucoup à défendre l’idée d’un débat critique sur les fondements de l’économie politique et à avoir une vision différente qui permette vraiment de sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons.
Mais quels pourraient en être les remèdes ?
Il faut redonner son propre rôle à l’Etat dans l’économie, mais pour ce faire, il s’agit de lui en donner les moyens, en évitant l’actuelle course à la baisse de la fiscalité et cesser d’agiter la menace qu’une augmentation des impôts n’engendrera que le départ des bons contribuables. La fiscalité n’est qu’un facteur parmi d’autres lorsqu’on choisit son lieu d’établissement. Il y en a d’autres: la qualité de vie et des services, la sécurité et la stabilité ou, pour les entreprises, le niveau de formation et le profil de la main-d’œuvre.
Pietro Gianolli/vbo